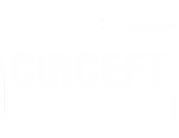Nada Chaar
Nada Chaar est docteure en sciences de l’éducation.
- PRAG. UFR SEPF (Sciences de l’éducation, Psychanalyse, Com-Fle), Université Paris 8-Vincennes-Saint-denis
- Membre de l’équipe Escol.
Thématiques de recherche
-
Sociologie de l’éducation
-
Sociologie de l’école et du groupe professionnel enseignant
-
Sociologie des mobilisations
-
Sociologie de l’animal
Publications et communications
Pour accéder à la bibliographie renseignée sur HAL, cliquez ici.
Publications scientifiques :
Articles dans des revues à comité de lecture
- « Éduquer à quoi ? Rapport au métier et rapport à l’école chez les enseignants débutants du second degré », Educations et sociétés, 2023/2, n°49, p. 33-49. DOI : 10.3917/es.050.0033. URL : https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2023-2-page-33.htm
- « Mission vs. raison. Comment le mode d’entrée subjective dans le métier d’enseignant du secondaire influence-t-il l’engagement professionnel ? », Inter Pares α, 2015, p. 17-26.
- Avec Y. Baunay, « La QVT, aliment ou produit de la controverse au sein du collectif de travail. Une recherche-action menée dans un lycée parisien », La Revue des conditions de travail, n°3, décembre 2015, p. 83-89, https://www.anact.fr/la-qvt-aliment-ou-produit-de-la-controverse-au-sein-du-collectif-de-travail.
- Avec I. Pereira, « Immanence, dévoilement et réflexivité. Faire de la sociologie à partir d’une implication militante sur le lieu professionnel », Interrogations, n° 19, Implication et réflexivité – II-Tenir une double posture, décembre 2014, http://www.revue-interrogations.org/Immanence-devoilement-et.
- « Le non-engagement des enseignants, une abdication du politique ? », Les cahiers du travail social, n° 69, mai 2012, p. 77-91.
Chapitres d’ouvrages
- A paraître: « La socialisation professionnelle comme socialisation politique. Les politiques scolaires à l’aune des représentations des enseignants débutants du second degré général et technologique public », Actes du colloque « Fabrique politique de l’école, fabrique scolaire du politique », IEP d’Aix-en-Provence, 21-22 octobre 2021, dans la collection Paradoxa, Presses du Septentrion (PUS).
- Avec Yves Baunay, « Inventer les temporalités du syndicalisme. Les heures d’information syndicale comme instance d’adaptation de l’agenda syndical aux urgences locales », in Grosse, E. Labaye et M. Ollivier dir., Syndicaliste : c’est quoi ce travail ?, Paris, Syllepse, 2017.
- Avec I. Pereira, « La place des rapports hiérarchiques dans la souffrance au travail des stagiaires de l’Education nationale », in Ferrette dir., Souffrances hiérarchiques au travail : l’exemple du secteur public, Paris, L’Harmattan, 2014.
- « Des enseignants non grévistes, les stagiaires », L. Frajerman dir., La grève enseignante, en quête d’efficacité, Paris, Syllepse, 2012.
- « Pouvoirs publics, usagers, syndicats et enseignants, des discours antinomiques sur l’école », in A. Donteville-Gerbaud dir., Approches pluridisciplinaires des discours sur l’école en Seine-Saint-Denis, Créteil, CRDP, 2012.
Communications scientifiques :
Communications dans des colloques ou journées d’étude avec actes
- « La socialisation professionnelle comme socialisation politique. L’entrée dans l’action collective des enseignants débutants du second degré général et technologique public », Colloque Fabrique politique de l’école, fabrique scolaire du politique, IEP d’Aix-en-Provence, 21-22 octobre 2021. *Communication à paraître dans un ouvrage collectif de la collection Paradoxa, dirigée par Bruno Ambroise et Patrick Lehingue, aux Presses du Septentrion (PUS).
- Avec I. Pereira, « Souffrance au travail et rapports hiérarchiques dans la fonction publique. Le cas des stagiaires de l’enseignement secondaire dans la réforme Chatel », La place des rapports hiérarchiques dans la souffrance au travail. L’exemple du secteur public, colloque syndical et scientifique, Sud-Éducation, Paris, 25-26 octobre 2012.
- « Pouvoirs publics, usagers, syndicats et enseignants, des discours antinomiques sur l’école », colloque Approches pluridisciplinaires des discours sur l’école en Seine-Saint-Denis, IUFM de Créteil, 1-2 avril 2011.
Communications dans des colloques sans actes
A l’étranger
- “Importing one’s own trajectory into one’s teaching habits in order to face students’ difficulties and the challenges of the knowledge economy”, ERUA SUMMIT 2023, “Why Universities? Reimagining Higher Education and Research”, Roskilde University, Danemark, 10-11 octobre 2023.
En France
- « La socialisation professionnelle comme socialisation politique. L’entrée dans l’action collective des enseignants débutants du second degré », Colloque Fabrique politique de l’école, fabrique scolaire du politique, Science Po Aix, 21-22 octobre 2021.
- « S’engager dans le métier d’enseignant. Rapports au métier, à la profession et à la mobilisation des enseignants débutants dans le secondaire public, général et technologique », Colloque Condition(s) enseignante(s), conditions pour enseigner, Lyon, 8-10 janvier 2015.
- Avec I. Pereira, « Résister ou tenir, les stagiaires et la réforme de la formation des enseignants du secondaire », Congrès AFS, RT 18, Relations professionnelles, Université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
- « Devenir stagiaire dans la précarité. Les stagiaires dans la réforme Chatel de la formation des enseignants », Congrès AFS, RT1, Savoirs, travail, professions, Université de Nantes, 2-5 septembre 2013.
- « Comment se mobiliser, une approche ethnographique du rapport à l’action collective des professeurs de l’enseignement secondaire», Congrès AFSP, IEP de Paris, 9-11 juillet 2013, http://www.afsp.info/archives/congres/congres2013/st/st30/st30chaar.pdf.
Communications dans des journées d’étude sans actes
- « L’action collective comme modalité de la socialisation professionnelle. L’entrée dans le métier des enseignants débutants du second degré », Journée d’étude Les Engagements professionnels et militants des enseignants : évolutions et articulations, Université de Lille, 27 novembre 2020 (à distance).
- « Quelle place de l’esprit critique dans les valeurs et la socialisation professionnelle des enseignants débutants ? », Journée d’étude Formation à l’esprit critique, Espé de l’académie de Créteil, 6 décembre 2017.
Thèse :
Titre
Entrer dans l’action. Socialisation au métier et socialisation à l’action collective des enseignants débutants du second degré général et technologique public
Résumé
Les enseignants forment un groupe mobilisé et marqué par une forte tradition syndicale. Cet héritage semble néanmoins en crise dans un contexte de renouvellement socio-démographique et générationnel du groupe et d’importantes transformations institutionnelles. Les génération les plus récentes d’enseignants entretiennent un rapport plus distancié à la profession et à ses organisations, que notre recherche doctorale à exploré à travers la rencontre entre les dispositions que les individus importent dans l’espace professionnel et les processus de socialisation professionnelle à l’action collective. Un enquête longitudinale, quantitative et qualitative, a été menée auprès de 112 enseignants du second degré général et technologique public pendant leurs trois premières années de carrière en Île-de-France, entre 2011 et 2014. Ce travail observe d’abord les propriétés socio-scolaires des enquêtés et leurs représentations du métier, restées proches de celles des enseignants recrutés depuis la création des IUFM dans les années 1990. Il s’attache ensuite à décrire une entrée dans le métier par la difficulté : celle de l’année de stage, dans un contexte particulier de réforme de la formation, mais aussi, plus généralement, des premières années, celles des affectations sur postes de remplacement et dans les établissements de l’éducation prioritaire. Dans ces contextes, la troisième partie montre que presque tous les individus participent à l’action collective. Cette participation se différencie en fonction de leurs dispositions politiques importées et de leur capacité à s’ancrer dans des espaces locaux de mobilisation. L’établissement apparaît, pour ceux qui trouvent à s’y stabiliser, comme un espace particulièrement efficace d’enrôlement des individus, quelles que soient leurs dispositions politiques importées, dans l’action collective. Une analyse des correspondances multiples et une classification ascendante hiérarchique, achèvent ce travail. Elles montrent qu’une partie minoritaire des individus évitent l’action collective dans ses dimensions les plus syndicales et politiques mais finissent par y entrer par la participation à la vie institutionnelle locale de l’établissement. Les individus les plus isolés professionnellement mettent à profit l’assistance et les informations des syndicats. Enfin, une partie minoritaire mais importante des individus, politisés à gauche et favorablement disposés à l’égard de l’action collective contestataire/revendicative, inscrits dans des situations locales de mobilisation, apparaissaient comme investissant l’action collective dans toutes ses dimensions.
Projets de recherche
L’individualisation de l’institution scolaire vue à travers le prisme enseignant
L’éducation canine au cœur de la transformation urbaine
Evaluation d’articles pour des revues à comité de lecture
- Juillet 2025. Penser l’éducation, Revue de philosophie de l’éducation et d’histoire des idées pédagogiques, Presses universitaires de Rouen et du Havre.
- Juillet 2023. Recherches féministes. Revue Scientifique francophone à diffusion internationale. Université Laval, Québec.
Responsabilités scientifiques
Participation à des comités scientifiques
- Participation au comité de lecture du numéro alpha de la revue de doctorants Inter pares, 2015 (Ecole doctorale Education, psychologie, information, communication, Université de Lyon).
Responsabilités éditoriales
- Frajerman (dir.), La grève enseignante, en quête d’efficacité, Paris, Syllepse, 2012, p. 30-36.
Responsabilités administratives et pédagogiques
-
Depuis 2025: responsable de la Licence 3 de Sciences de l’éducation
- 2023-2025: co-responsable de la Licence 1 de Sciences de l’éducation; responsable de la Commision pédagogique de la Licence de Sciences de l’éducation.
- 2022-: responsable du dispositif de préprofessionnalisation de la Licence de Sciences de l’éducation: Journée Avenirs
- 2021-2022 : responsable du Champ de professionnalisation (CP1) de la Licence de Sciences de l’éducation : Ecole et enseignement.
- 2020-2021 : membre de la commission d’examen des dossiers de candidature à l’axe ENJEUFOR (Enfance, jeunesse, formation) du Master. Département de Sciences de l’éducation de l’UFR SEPF (Sciences de l’éducation, psychanalyse, com-Fle). Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis.
- Depuis 2016-2017 : membre de la commission pédagogique du département de sciences de l’éducation. UFR SEPF (Sciences de l’éducation, psychanalyse, com-Fle). Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis.
Contribution à la diffusion de la littérature scientifique
- Membre du réseau Expertes.fr, https://expertes.fr/expertes/73802-nada-chaar/
- Carnet de recherches : Enseigner dans le secondaire. Profession métier, travail, action collective, sur la plateforme académique Hypotheses.org, https://enseigner.hypotheses.org/.
-
Contributions régulières sur le site nonfiction.fr : chroniques scolaires (2026-2019), sociologie de l’animal : https://www.nonfiction.fr/fiche-perso-1715-nada-chaar.htm.