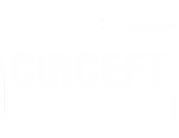REGROUPEMENTS RESEIDA 2024-2025
Le 14 novembre est une journée consacrée au travail de Xavier Pons sur les politiques éducatives, avec proposition de corpus par l’intervenant.
Le 15 novembre est une journée consacrée au travail des axes de recherche du réseau.
Le 20 janvier 2025 est une journée de présentation et de discussion organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage sur la recherche Reseida ACCI (Adaptations constextualisées du curriculum et inégalités).
Le 21 janvier est une journée consacrée au travail des axes de recherche du réseau.

Journée d’étude consacrée à la sortie de l’ouvrage
Des différences curriculaires en classe de 6e.
Une analyse de cahiers d’élèves d’établissements socialement différenciés
20 janvier 2025 – Université Paris Cité, site des Grands moulins
Bâtiment Olympe de Gouges – place Paul Ricœur 75013 – salle 105
Le réseau RESEIDA organise une journée autour de la publication d’un ouvrage collectif dirigé par Élisabeth Bautier et Marion van Brederode.
L’ouvrage fait la synthèse d’une recherche qui a porté sur le recueil et l’analyse des traces produites par les élèves de 6ème dans les cahiers lors des activités de classe en français et en sciences de la vie et de la Terre et scolarisés dans des établissements aux populations socialement contrastées. En première lecture, ces traces paraissent assez identiques, mais leur analyse qualitative puis quantitative permet de mettre au jour des différences significatives dans la nature du travail cognitif et langagier sollicité chez les élèves en fonction du contexte social.
La journée du 20 janvier sera l’occasion de présenter l’ouvrage, les méthodes d’analyse qualitative et quantitative mises en œuvre et les principaux résultats. Cette présentation sera suivie d’échanges avec des lecteurs de spécialités différentes : sociologie, didactique des sciences et sciences du langage.
Cette journée est ouverte à tous les publics potentiellement intéressés par la co-construction des inégalités scolaires et sociales souvent peu visible au sein des pratiques ordinaires.
Programme
Matin
10h : Stéphane Bonnéry (Circeft Escol, U Paris 8) : Méthodes de recherches sur les inégalités d’apprentissage
10h30 : Élisabeth Bautier (Circeft Escol, U Paris 8) et Marion van Brederode (Afordens, Université de Genève) : Exposé général sur les résultats de l’ouvrage
11h : Discussion
11h30 : Ariane Richard Bossez (Mesopolis, AMU): Une lecture particulière du texte depuis la sociologie
12h10 – 13h : Discussion
Après midi
14h30 : Andrée Tiberghien (ICAR, ENS Lyon) : Une lecture particulière du texte depuis la didactique des sciences
15h : Discussion
15h30 : Martine Jaubert (Laces, U Bordeaux) : Une lecture particulière du texte depuis les sciences du langage
16h : Discussion 30mn
16h30 : Claire Benveniste (Circeft Escol, UPEC) : En quoi l’ouvrage et les discussions donnent-ils des pistes pour la formation des enseignants
17h : Fin de la journée
Séminaire sur la formation des enseignants dans plusieurs pays du sud de l’Europe.
Le lundi 2 juin 2025 est une journée divisée en deux intervention. Matin: Philippe Losego et Héloïse Dürler pour un bilan du colloque « Former contre les inégalités » organisé à Lausanne en septembre 2021. Après-midi: Morgane Le Gouellec présentera son travail de thèse sur la formation des enseignants aux relations avec les élèves.Le mardi 3 juin est une journée consacrée au travail des axes de recherche.
RÉSEAU RESEIDA

Le réseau RE.S.E.I.D.A (Recherches sur la Socialisation, l’Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les Apprentissages) a été créé en 2001 à l’initiative d’Élisabeth Bautier et de Jean-Yves Rochex (équipe ESCOL). Après un travail de mise en commun des convergences, des problématiques, et des résultats de recherches des différentes équipes autour de la question des inégalités et des processus différenciateurs à l’école, le réseau s’engage dans plusieurs recherches communes réparties selon les axes du réseau.
Les regroupements ne sont ouverts qu’aux membres du réseau de recherche RESEIDA. Si vous souhaitez y assister en tant qu’extérieur, vous pouvez contacter Christophe Joigneaux, Elise Vinel ou Julien Netter.
Les regroupements ont lieu dans les locaux de l’Université Paris Diderot, 75013 Paris (métro ligne 14 et RER C : stations Bibliothèque François Mitterrand).
Lors de ces regroupements, outre la journée consacrée à l’accueil de conférenciers pour échanger sur des problématiques diverses, une autre journée permet le travail des axes de recherche.
Les activités de recherche de Reseida sont structurées autour de quatre axes de recherche :
- L’axe Dispositifs
L’axe Dispositifs s’intéresse à la façon dont des projets pédagogiques et didactiques, incarnés dans des agencements particuliers, contribuent à perpétuer, augmenter ou réduire les inégalités d’apprentissage. Ses premiers travaux, consacrés à la classe inversée, ont visé à comprendre si et en quoi ce dispositif dit innovant favorise ou non la mise en place de contrats (social, pédagogique, didactique) bénéfiques aux apprentissages de tous les élèves. Ils se sont progressivement centrés sur le travail en groupe des élèves, récurrent dans ce type de pédagogie, pour en cerner les enjeux, les angles morts, repérer les situations dans lesquelles la coopération engendre des gains cognitifs. Parallèlement est étudié un autre dispositif, celui par lequel des chercheurs et des praticiens mettent en œuvre, sur un mode de lesson study, des séquences d’enseignement. Celles-ci constituent le matériau d’une autre branche de la recherche, destinée à mettre en évidence les conditions dans lesquelles des chercheurs et des praticiens peuvent lutter de façon conjointe contre les inégalités d’apprentissage.
Responsable de l’axe : Patrick Rayou
- L’axe Politiques éducatives
L’axe Politiques Educatives vise à analyser de façon comparée les politiques éducatives de lutte contre les inégalités scolaires. Dans une approche inter-scalaire de l’action publique, il mobilise différentes échelles d’analyse : les dispositifs, les établissements, les classes, à différents niveaux (international, national, académique). Plus spécifiquement, l’axe interroge la résonance entre ces différentes échelles et niveaux, et analyse les incitations de plus en plus fortes à une différenciation croissante de l’offre de formation et des parcours ou trajectoires scolaires. L’axe s’intéresse à la définition des catégories de population ciblées par ces politiques, ainsi qu’à la définition sociale ou éducative de ces populations, pour étudier les effets des politiques sur les pratiques professionnelles et sur l’accès des élèves aux savoirs et aux apprentissages. La réalisation de ce programme de recherche, ambitieux, est envisagé dans la mise dans le dialogue entre les différents travaux menés par ses membres.
Responsables de l’axe : Cintia Indarramendi et Maíra Mamede
- L’axe Pratique d’évaluation
Les évaluations nationales, comme internationales, proposées à différents moments de la scolarité des élèves produisent des résultats qui témoignent inlassablement d’inégalités scolaires en lien avec le milieu social fréquenté par les élèves et leur genre. Au-delà des constats statistiquement établis, les travaux menés dans cet axe visent à mieux comprendre la complexité des phénomènes en jeu dans le contexte de ces évaluations en croisant différentes approches pour les étudier (didactique, psychosociale, etc.). Les premiers travaux menés dans cet axe se sont intéressés aux écarts de performance entre les filles et les garçons dans le cadre des évaluations Repères de CP et de CE1 en mathématiques. Ils ont produit des résultats autour de l’intégration de stéréotypes de genre chez les élèves et les professeur·es, mais aussi autour de la validité des taches mathématiques proposées et de la façon dont les réponses des élèves sont codées et interprétées. Ces premiers résultats méritent d’être approfondis dans des recherches complémentaires actuellement menées au sein de cet axe.
Responsable de l’axe : Nathalie Sayac
- L’axe Pratiques enseignantes
L’axe Pratiques enseignantes cherche à caractériser les pratiques enseignantes en relation avec leur genèse et leurs effets. L’objectif ici est d’apporter un éclairage supplémentaire par rapport aux travaux existants essentiellement appuyés sur des observations ponctuelles de pratiques. L’hypothèse est qu’un travail longitudinal doit permettre de faire apparaitre leur plus grande variabilité (intra ou interindividuelles) de pratiques, en offrant la possibilité d’observer la façon dont elles s’articulent aux contextes dans lesquels elles s’inscrivent, ou encore aux trajectoires socio-professionnelles des enseignants et aux processus d’apprentissage des élèves dont certains sont inscrits dans la durée. Il s’agirait ainsi d’approfondir la caractérisation des pratiques enseignantes en relation avec les contextes dans lesquels elles se développent et des conséquences qu’elles peuvent avoir sur les inégalités d’apprentissage des élèves.
Responsables de l’axe : Julien Netter et Christophe Joigneaux
ARCHIVES DES REGROUPEMENTS DU RÉSEAU RESEIDA
Les regroupements ne sont ouverts qu’aux membres du réseau de recherche RESEIDA. Si vous souhaitez y assister en tant qu’extérieur, vous pouvez contacter Christophe Joigneaux, Elise Vinel ou Julien Netter.
Le premier regroupement RESEIDA 2023-24 a eu un double objectif.
La matinée a visé à synthétiser le travail de l’année précédente, faisant émerger les points les plus importants abordés dans les regroupements de l’année 2022-23. Le groupe s’est appuyé sur les productions de « grands témoins » mobilisés lors de chaque regroupement pour opérer une synthèse écrite des interventions selon quatre grandes directions propres au réseau : les inégalités d’apprentissage, l’administration de la preuve, les différentes échelles d’analyse, l’explicitation. Pour chacune de ces directions, les membres présents se sont demandé en quoi leurs approches avaient été déplacées par les interventions, ce qu’ils pouvaient en retenir pour leurs recherches futures.
L’après-midi a permis de présenter le travail de l’axe « Pratiques enseignantes ». Conformément à la politique de regroupements initiée depuis 2022, les membres de l’axe ont proposé à l’assemblée de travailler sur un extrait de corpus ayant servi de base à de nombreuses analyses. Une telle pratique, qui s’éloigne du modèle de la simple conférence, vise d’une part à ce que l’assemblée s’approprie plus efficacement les questionnements et résultats des intervenants, et permet d’autre part aux intervenants de bénéficier d’un regard extérieur qui intervient directement sur le corpus travaillé. Il s’agit donc de favoriser les déplacements mutuels des points de vue. La séance a ainsi permis d’interroger les différents types de savoirs en jeu dans la situation, dépassant parfois ce que l’on a coutume d’appeler « savoirs ».
Le deuxième regroupement Reseida 2023-24 est l’occasion d’entendre et de discuter des interventions d’Emmanuel Sander (faculté de sciences de l’éducation, UNIGE) et d’Eric Roditi (EMA, Université Paris Cité).
La première présentation a porté sur une enquête à grande échelle menée par Éric Roditi et une équipe de didacticiens, ainsi que par des professionnels de l’enseignement primaire sur les pratiques d’enseignement des mathématiques en CM2. Le collègue a présenté les modalités d’enquête, les choix méthodologiques opérés pour exploiter les données recueillies, ainsi que certains résultats obtenus. Une esquisse d’une recherche en cours visant l’exploitation de cette enquête pour tenter de mettre en lien pratiques d’enseignement et apprentissages des élèves, toujours en mathématiques et en CM2, a également été présentée. L’objectif de cette enquête a alors été de tenir compte des apports de la didactique sur l’enseignement et l’apprentissage de contenus disciplinaires, mais aussi des caractéristiques personnelles des professeurs enquêtés, de leur parcours professionnel et des contextes d’enseignement.
Il a été question dans la seconde présentation de concepts, d’analogies et d’apprentissages.
Emmanuel Sander s’est appuyé sur différents corpus pour souligner que la nouveauté dans les apprentissages est abordée par le biais de concepts préexistants. C’est ainsi par analogie avec le connu, que l’être humain s’approprie l’inconnu et capitalise ses expériences. Dans cette perspective, ce qui est perçu l’est nécessairement à travers des constructions psychologiques préalables, mobilisées dans toute interaction sensible et qui orientent la manière d’interagir avec son environnement, d’interpréter une situation, de raisonner, de prendre des décisions, de construire de nouvelles connaissances. Les notions scolaires ne font pas exception et sont ainsi d’abord appréhendées par le filtre du connu. Emmanuel Sander se demande alors comment favoriser à l’école le dépassement d’une compréhension spontanée, inévitable mais limitante.
Le séminaire international à distance, organisé en avril 2024, a rassemblé une cinquantaine de personnes issues de cinq pays (Brésil, Argentine, Chili, Canada, France). Il a porté sur le cas intéressant de la province du Ceara au Brésil, l’une des plus pauvres du pays, dont les écoles ont vu les performances scolaires de leurs élèves croître considérablement en peu d’années. Pour tenter d’en comprendre les raisons, quatre interventions à plusieurs voix d’une vingtaine de minutes se sont succédés, suivies d’une discussion d’une heure. Sont intervenus Sylvain Broccolichi (CIREL, Lille, France), Maria do Carmo Mereilles Toledi Cruz (UNICID – Sao Paulo, Brésil), Maria da Conceição Passeggi (UFRN – Université Fédérale du Rio Grande do Norte), Roberto Gimenez (UNICID – Sao Paulo, Brésil), Christophe Joigneaux (Circeft ESCOL, UPEC, France), Maíra Mamede (Circeft ESCOL, UPEC, France), Isa Mariano Sá (UNICID – Sao Paulo, Brésil), Sergio Martinic (Université de Aysén, Chili), Rodnei Pereira (UNICID – Sao Paulo, Brésil). La présentation de Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz, Maíra Mamede et Rodnei Pereira a porté sur la mise en œuvre des politiques éducatives et les inégalités apparues dans le contexte de la pandémie de covid-19. Deux présentations se sont penchées sur l’expérience du Ceará. La première de Christophe Joigneaux, Maíra Mamede, Rodnei Pereira, Sylvain Broccolichi, Maria do Carmo M. T. Cruz et Isa Mariano Sá s’est intéressé aux liens entre les pratiques d’enseignement et les apprentissages des élèves. La seconde de Rodnei Pereira, Sylvain Broccolichi, Maria do Carmo M. T. Cruz, Maíra Mamede, Isa Mariano Sá et Christophe Joigneaux s’est penchée sur les ressources mobilisées à l’école pour favoriser les apprentissages des élèves. Une dernière présentation de Sergio Martinic et Roberto Gimenez est revenue sur des observations réalisées pré- et post-pandémie avec la méthode Stallings, en particulier en étudiant les interactions en classe, dans une école à Fortaleza.
Le troisième regroupement Reseida porte sur l’analyse et la discussion d’un corpus fourni par Florence Le Hebel et Mylène Duclos (UMR ICAR, ENS Lyon). L’analyse est suivie d’une présentation des deux intervenantes.Dans un premier temps, les intervenantes ont présenté rapidement le cadre d’un projet mené conjointement à partir de l’enquête PISA, leur question de recherche et un corpus vidéo recueilli à cette occasion. La recherche vise à aller au-delà du codage de l’OCDE et de mieux éclairer les raisons pour lesquelles les élèves produisent une réponse ou une autre lors de la passation du test PISA. Plusieurs binômes d’élèves sont filmés tandis que leur sont soumis des items PISA « libérés » extraits des épreuves de sciences, puis lors d’entretiens d’explicitation rétrospectifs. Les membres du réseau présents se sont répartis pour analyser le corpus fourni et partager les lignes « reseidiennes » qu’ils pouvaient en tirer. Une confrontation des analyses a alors eu lieu.
L’après-midi a été consacré à une conférence plus classique des deux intervenantes, où elles ont présenté les résultats de leurs recherches visant in fine à identifier l’influence du statut socio-économique et culturel des élèves sur la compréhension et l’acquisition de composantes de la culture scientifique à la fin de l’école obligatoire. Elles ont montré comment, lorsqu’elles faisaient repasser à des élèves choisis les épreuves PISA, elles observaient des faits non répertoriés par PISA qui informaient sur les liens entre position sociale et performances en sciences. Elles ont insisté sur les liens entre approches quantitatives et qualitatives dans leur travail et ont engagé avec l’assistance des échanges prolongés.
Le premier regroupement 2022-23 a lieu les 17 et 18 octobre 2022
L’axe « Classe inversée » de Reseida présentera son travail et proposera deux corpus inédits pour une analyse collective par les membres du réseau.
Sous-groupe « Géographie »
La présentation fera un point très provisoire sur la recherche coopérative en cours concernant le travail en ilots en classe inversée (Mickaël Bertrand, Yann Coudreau, Georges Ferone, Patrick Rayou, Françoise Robin). La leçon analysée est un élément d’un cours de géographie consacré à « Mers et océans dans la mondialisation ». Son déroulé a été élaboré en concertation entre l’enseignant de la classe, une autre enseignant et les chercheurs. Les échanges entre élèves au cours du travail de groupe qui a suivi le travail individuel sur des documents selon une logique de « puzzle » ont été enregistrés et transcrits ainsi que des entretiens avec 14 élèves de la classe. Après analyse collective au sein de l’équipe, une leçon sur le même thème sera à nouveau élaborée et faite à des élèves de même niveau. L’exposé tentera d’apprécier en termes d’explicitation les effets du travail de groupe qu’il mettra en relation avec les consignes données, les concepts à mobiliser, le dispositif « puzzle », le diaporama à confectionner.
Sous groupe « Français »
Dans le cadre de la recherche Reseida sur la classe inversée, nous nous interrogeons actuellement sur le travail de groupe comme modèle pédagogique et sur sa pertinence didactique pour permettre des échanges intersubjectifs interprétatifs lors de la lecture de textes littéraires. Les élèves très souvent se cantonnent dans des remarques formelles, au risque de ne pas chercher à interpréter le texte. Nous tentons de comprendre ce qui, dans les dispositifs, consignes et étayages, aide ou empêche les élèves de construire des interprétations pertinentes, en nous appuyant sur les interactions au sein des petits groupes et sur des entretiens conduits avec des élèves après la séance. Les exemples pris concernent des classes de 4e et de 1re. (Valérie Boucher, Marie-Sylvie Claude, Jacques Crinon, Patrick Rayou, Luc Ria, Élisabeth Soulassol, Cendie Waszak)
Le deuxième regroupement Reseida 2022-23 tourne autour de deux interventions autour du métier d’enseignant.
Le séminaire FELIS : tenter d’analyser les relations entre politiques, formations et pratiques génératrices d’inégalités d’apprentissage
Sylvain Broccolichi, Christelle Dormoy-Rajramanan, Stephan Mierzejewski (CIREL-RECIFES, Université de Lille) & Christophe Joigneaux (CIRCEFT-EScol, UPEC).
La communication présentera l’orientation spécifique du séminaire FELIS, – Formation et lutte contre les inégalités scolaires ; des politiques aux pratiques – que nous avons organisé à l’université de Lille depuis 2019: ce qui l’a motivée et ce qui ressort pour nous des échanges en son sein. Nos trajectoires de chercheurs et de formateurs d’enseignants ont nourri de longue date nos interrogations sur les évolutions extrêmes des inégalités socio scolaires constatées en France, et sur leurs liens avec les politiques infléchissant les conditions cognitives et pratiques d’apprentissage et d’exercice de l’enseignement. Le développement des recherches sur les formations des enseignants, sur leurs socialisations professionnelles, leurs vulnérabilisations et leurs désengagements ont ensuite confirmé la nécessité pour nous de rapporter les pratiques pédagogiques inégalitaires à un large ensemble de paramètres institutionnels et locaux qui conditionnent les ressources et contraintes pesant sur ces pratiques.
Étudier le « beau travail » des enseignant.e.s: quel intérêt pour les élèves, la profession et la formation ?
Thierry Bouchetal (ISPEF, Université Lyon 2) ; Andrea Capitanescu Benetti (LIFE, Université de Genève).
Cette communication présentera une recherche en cours, conduite par les laboratoires LIFE de Genève et ECP de Lyon, sur le rapport des enseignants à leurs pratiques, en particulier celles qu’ils/elles peuvent qualifier de « Beau travail » en se remémorant des situations d’enseignement/apprentissage vécues en classe. Le matériau est composé de 27 entretiens individuels (de la maternelle au secondaire) réalisés en France et dans le canton de Genève, ainsi que de 9 focus groupes (en cours de réalisation). A cette question inédite, les enseignant.e.s répondent, entre autres, en mettant en avant des situations qu’ils jugent singulières, dans lesquelles ils font principalement référence au groupe classe (et moins à des situations d’individualisation) et à des activités qui s’écartent de formes ordinaires d’enseignement. Cette recherche ouvre des perspectives renouvelées pour la formation des enseignants à partir des potentiels de l’activité (plutôt que de ses empêchements), y compris autour de l’élaboration, entre pairs,de « jugement de beauté » (au sens de Dejours).
Le troisième regroupement est l’occasion d’analyser un corpus présenté par Gérard Sensevy (UBO) et Sophie Poilpot (LéA DEEC-ACE), dont la discussion est suivie d’une conférence.
Des dispositifs de solidarité épistémique pour reconstruire la forme scolaire.
Quelques hypothèses de travail
Gérard Sensevy, Université de Bretagne Occidentale
Sophie Poilpot, école des Coteaux, Plédran (22), LéA DEEC-ACE, Université Côte d’Azur
Dans cette intervention, je m’appuie sur un corpus constitué d’un ou plusieurs extraits de film de la pratique, en mathématiques au début de l’école primaire.
Je décris tout d’abord en substance, et de manière générique, une dialectique fondamentale de l’action didactique, celle qui s’établit entre la réticence (ce que fait le professeur quand il tait ou cache des éléments essentiels du savoir qu’il a l’intention de transmettre) et l’expression (ce que fait le professeur quand il verbalise ou montre des éléments essentiels du savoir qu’il a l’intention de transmettre). Je produis l’hypothèse selon laquelle cette dialectique est souvent mésestimée dans certains travaux qui prônent soit un « enseignement explicite » soit « un enseignement constructiviste ».
Dans une seconde partie de l’intervention, je tente de montrer comment une appréhension pertinente de cette dialectique réticence-expression peut amener à produire un enseignement structuré en dispositifs de solidarité épistémique. Ces dispositifs reposent essentiellement sur le travail, commun à chacun·e des élèves de la classe, de questions et problèmes identiques, initialement par exemple au sein d’exemples travaillés qui les érigent en exemples emblématiques, et sur l’enquête de longue durée des élèves sur ces questions et problèmes.
Dans une dernière partie, je tente de montrer comment de tels dispositifs pourraient contribuer à une reconstruction de forme scolaire, en produisant un autre temps didactique que le temps didactique classique, dans une activité didactique en parenté épistémique avec la pratique des connaisseurs pratiques des savoirs inculqués.
Corpus
Le corpus auquel cette intervention sera articulée est issu d’une recherche ANR en cours (DEEC : Détermination d’Efficacité des Expérimentations Contrôlées). L’objet de cette recherche est la création-résolution de problèmes d’arithmétique, par les élèves, en début d’école primaire, au sein d’une ingénierie coopérative réunissant professeurs et chercheurs.
Roland Goigoux : « Cinq focales pour structurer un débat avec RESEIDA et avec les équipes de recherche qui visent à contribuer à l’amélioration et à la démocratisation des pratiques d’enseignement.»
Dans son exposé, Roland Goigoux reviendra sur quelques exemples emblématiques de conflits sociocognitifs chers à RESEIDA pour présenter les cinq focales (Cinq focales pour aider les formateurs à analyser l’activité d’enseignement | Le Club de Mediapart) qu’il propose pour analyser ces pratiques. Cela le conduira à reprendre une partie de l’argumentaire déployé lors de l’interview donnée à propos de l’article publié avec Elisabeth Bautier en 2004 dans la revue française de pédagogie : « Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes : une hypothèse relationnelle ». Il s’interrogera sur ce qui reste de cette hypothèse relationnelle vingt ans plus tard.
Pour ceux qui souhaiteraient préparer le débat, l’interview est disponible ici : https://drive.uca.fr/f/e7e2230e3f3d402c9cb9/
et ici temporairement : https://www.youtube.com/watch?v=GKEyK2LSlJs
L’article est ici : https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_2004_num_148_1_3252
André tricot : « Peut-on interpréter conjointement les résultats d’un essai randomisé contrôlé et d’observations en classe ? »
Dans 90 % des cas, le passage à l’échelle de résultats expérimentaux obtenus dans des conditions contrôlées avec de petits échantillons, vers des situations de classe et de gros échantillons, est un échec (Gurgand, 2018). En outre, les essais randomisés contrôlés ne produisent pas d’explication causale de l’efficacité ou de l’inefficacité d’une intervention. Une piste est donc de conduire des recherches plus qualitatives, fondées sur l’observation et visant à comprendre des pratiques d’enseignant.e.s, pour identifier les causes de la réussite ou de l’échec d’une intervention évaluée par essai randomisé contrôlé, notamment pour évaluer la distance entre ce qui a fonctionné à petite échelle et ce qui n’a pas fonctionné à grande échelle. La recherche FORMSCIENCES visait à évaluer l’effet d’une formation d’enseignants à la démarche d’investigation selon une double approche : essai randomisé contrôlé impliquant 134 enseignants et plus de 3000 élèves ; une analyse didactique à partir d’observations (de quelques formations réalisées lors de ce projet et de quelques classes impliquées) et d’entretiens. Je discuterai des causalités établies dans cette recherche et des pistes envisagées actuellement pour parvenir à mieux cerner cette causalité.
Le deuxième regroupement traite des questions de numérique éducatif et du passage à la classe à distance pendant la pandémie de COVID 19. Il est organisé autour de deux interventions.
- Romain Delès (Centre Emile Durkheim, Inspé de Bordeaux), Filippo Pirone (LACES Inspé de Bordeaux) et Séverine Chauvel (Lirtes, UPEC) rendent compte d’une enquête par questionnaire menée au moment du confinement.
- Julien Netter (Circeft Escol UPEC), Oriane Gélin (RECIFES CIREL), Laure Sochala (RECIFES CIREL), Léa Régibier (Circeft Escol), Christophe Joigneaux (Circeft Escol UPEC), Jacques Crinon (Circeft Escol, UPEC), Georges Ferone (Circeft Escol, UPEC), Grégory Train (LabE3D, Université de Bordeaux) exposent quelques conclusions de la recherche GTnum Pléiades.
L’expérience des familles et des enseignants français pendant le confinement de 2020 : entre ruptures et continuités
Séverine Chauvel (LIRTES – UPEC), Romain Delès (CED – Université de Bordeaux), Filippo Pirone (LIPHA – UPEC)
Notre communication a comme objectif de discuter les résultats d’une enquête collective menée entre mars 2020 et le premier trimestre de l’année scolaire 2020 et 2021. Pour cette enquête, nous avons interrogé par questionnaire 5869 enseignants et 31764 parents d’élèves autour de leur expérience éducative pendant le premier confinement de 2020. L’enquête s’est poursuivie par le biais de la réalisation d’entretiens semi-directifs avec 20 enseignants et 15 parents d’élèves.
La communication se déroulera en trois temps :
- Les parents : inégalités entre les familles, inégalités dans la famille
- Les répertoires professionnels des enseignantes et enseignants en REP
- Les transformations dans la relation enseignants-élèves-familles et dans les représentations et les pratiques enseignantes
- Les parents : inégalités entre les familles, inégalités dans la famille
L’accompagnement parental du travail scolaire reste peu étudié en sociologie de l’éducation. La tradition sociologique de la socialisation par osmose et de la transmission automatique du capital culturel est peut-être à l’origine de cette relative absence (Garcia, 2018). L’analyse de l’aide parentale pendant le confinement du printemps 2020 permet alors d’approcher les différences de pratiques entre les milieux sociaux. On distingue en particulier des pratiques d’encadrement du travail (construction d’un espace-temps scolaire) et des pratiques proprement pédagogiques (accompagnement des apprentissages, acquisition des notions). L’étude d’une séquence en ligne pendant le confinement montre les malentendus et les difficultés de décryptages des attendus par les parents que peuvent provoquer les plateformes pédagogiques numériques. Enfin, nous évoquons rapidement les modalités de l’accompagnement et montrons l’efficacité pédagogique possible du partage entre parents du suivi scolaire : quand les deux parents s’impliquent, les pratiques d’accompagnement et les méthodes d’apprentissage diffèrent et semblent se rapprocher du modèle de « l’accompagnement parental expert » (Kakpo et Rayou, 2018).
- Les répertoires d’action des enseignantes et enseignants en Education Prioritaire
Concernant les enseignants, l’enquête a montré que ceux exerçant en REP et REP+ ont consacré 2h09 de moins que les autres à leur activité professionnelle, alors que cet écart n’existe pas hors confinement. Ce constat surprenant est exploré à travers l’étude des trois répertoires d’action des enseignant.es exerçant en éducation prioritaire : le travail invisible, la résistance et l’expertise. Ces répertoires d’action expliquent à la fois que les enseignant·e·s de REP déclarent travailler moins tout en étant plus impliqué∙e∙s pédagogiquement.
- Les transformations dans la relation enseignants-élèves-familles et dans les représentations et les pratiques enseignantes
La fermeture des établissements scolaires et la mise en place de l’enseignement à distance ont eu comme effet de faire tomber un cadre, celui de l’espace scolaire, qui, malgré ses limites, permet de limiter la reproduction des inégalités sociales liées au capital culturel des familles : aux dires des enseignants interrogés, les taux de décrochage scolaire pendant la période ont été tristement spectaculaires, bien au-delà de ce qui avait été déclaré par le gouvernement. Malgré cela, cette période a permis aussi de rendre encore plus visibles qu’en temps normal une des « fonctions latentes » (Merton, 1949) de l’Ecole : celle de la fabrication et du maintien des liens sociaux (Durkheim, 1934). Il nous semble en effet que cette période a fonctionné comme un accélérateur des évolutions en cours de réalisation au sein de l’école, notamment en ce qui concerne les pratiques et les représentations des enseignantes et enseignants français et leurs relations avec les élèves et les familles. En ce sens, notre enquête montre que, malgré l’éloignement physique dû à la fermeture scolaire, les relations entre les acteurs scolaires n’ont jamais été aussi fréquentes et plutôt enclines à l’horizontalité (Bernstein, 2007).
L’école à l’épreuve du confinement. Présentation du travail de la recherche GTnum Pléiades
Le GTnum Pléiades étudie les transformations des pratiques des professeurs des écoles intervenues à l’occasion du passage à la classe à distance lors des confinements de mars 2020 et, dans une moindre mesure, avril 2021, et s’interroge sur leurs possibles effets en matière d’inégalités d’apprentissage. Il a donné lieu à différents recueils de données complémentaires engagés sur des terrains limités de trois académie (Lille, Bordeaux et Créteil), dans des écoles d’éducation prioritaire ou accueillant des publics socialement hétérogènes :
- Des observations de classes virtuelles captées en ligne pendant le confinement de mars 2020 puis pendant le confinement du printemps 2021 ou menées sur le lieu de travail des enseignants pendant le déconfinement en juin 2020 (n=23) ;
- Des entretiens individuels ou collectifs menés auprès de 29 enseignants entre juin 2020 et le printemps 2021 ;
- Un questionnaire sur les pratiques de classe à distance renseigné par les enseignants des terrains d’enquête (n=49) ;
- Un questionnaire destiné à interroger sur une plus grande échelle les pratiques en matière de classes virtuelles (n= 859)
Le séminaire Reseida sera l’occasion de présenter successivement des résultats issus de trois de ces recueils.
1- Quelles interactions en classe virtuelle pour quels étayages ? Conséquences possibles pour les inégalités d’apprentissage (Oriane Gélin, Laure Sochala, Christophe Joigneaux)
En raison de la distance spatiale qui peut exister entre élèves et enseignants au sein des classes virtuelles, les interactions qu’ils développent se trouvent nécessairement bouleversées. Nous nous intéressons aux conséquences en termes d’étayage et d’inégalités que peut avoir ce dispositif émergent à l’école primaire.
2- Enseigner à distance, un révélateur du rapport des enseignants au métier (Jacques Crinon et Georges Ferone)
Dans des entretiens conduits dans le cadre du GTNum Pléiades portant sur leur expérience d’enseignement pendant le confinement du printemps 2020, les enseignants expriment des degrés de satisfaction très contrastés. Nous avons fait l’hypothèse que la satisfaction et l’insatisfaction sont liées au rapport au métier. Une analyse de contenu de 23 entretiens met en évidence plusieurs dimensions explicatives : empêchement vs. renouvèlement du métier ; rupture vs. continuité avec des façons de faire antérieures ; occasion de formation vs. sentiment d’abandon ; progrès des élèves vs. décrochage ; conception d’une école ouverte sur les parents vs. spécificité du rôle de l’enseignant.
3- L’école à l’heure du confinement : regard quantitatif (Grégory Train)
Nous tenterons, à partir d’une enquête conduite auprès de 850 professeurs des écoles, de documenter les pratiques de classe mises en œuvre lors du premier confinement lié à la crise sanitaire de la COVID. Une analyse exploratoire multivariée tentera de mettre à jour différents profils de pratiques, en lien avec à la fois les relations avec les parents et le développement des usages de la classe virtuelle pendant cette période.
Le troisième regroupement de l’année 2021-22, sur l’administration de la preuve en éducation, est organisé autour de deux interventions:
Cédric Fluckiger (Cirel, Université de Lille)
A l’ère des évidence based policies et alors que les discours institutionnels ou médiatiques insistent sur le pouvoir transformatif des technologies sur l’éducation, la pression est forte pour que les chercheurs produisent des expertises visant à prouver que telle ou telle technologie serait « efficace ».
Les chercheurs doivent identifier à la fois l’origine de ces discours et les demandes qui sont adressées à la technologie (comme la demande régulièrement reformulée de « refonder » l’école) et à la recherche (notamment de « prouver l’efficacité »).
Il est également nécessaire pour les chercheurs en éducation de clarifier les modes d’administration de la preuve. Ils doivent enfin clarifier les relations entre recherche et pratique, en se situant par rapport à la tension fondatrice en sciences de l’éducation, entre les postures d’expertise (consistant à produire des évaluations de l’existant) et recherche (consistant à produire des connaissances). En effet, à l’opposition classique entre expertise et intervention d’un côté, analyse scientifique et suspension de l’action d’un autre, il est possible de porter une vision qu’on peut qualifier de critique.
Jean-François Rouet (Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage. CNRS Université de Poitiers)
Le deuxième regroupement a lieu le 22 mars 2021, en distanciel.
La matinée sera consacrée à la présentation par Benjamin Moignard (et peut-être Stéphanie Rubi) du séminaire consacré aux cités éducatives, dans lequel interviennent d’autres membres du réseau ;
L’après-midi sera l’occasion de faire un point de situation sur les travaux menés au sein des différentes axes, comprenant une intervention d’une heure sur « la classe inversée et le travail en îlots des élèves » par Jacques Crinon, Georges Ferone et Patrick Rayou.
Trois axes d’analyse sont privilégiés :
Le groupe de travail ne s’intéresse pas seulement à la version ordinaire de la classe inversée (la leçon à la maison/l’exercice en classe) et prend pour classe inversée ce que les enseignants enquêtés désignent comme tel. Néanmoins l’utilisation de capsules et du numérique en est une composante récurrente, dont le groupe étudie les incidences sur le travail des enseignants et sur celui des élèves. Par ailleurs, centrée sur des établissements secondaires où plusieurs enseignants disent pratiquer la classe inversée, cette étude prend en compte les aspects liés à la profession enseignante (clivages dans l’établissement, rôle du chef d’établissement, recherche de reconnaissance à l’intérieur et à l’extérieur…). L’enquête tient compte des aspects organisationnels de ces pratiques ainsi que des spécificités disciplinaires des enseignants concernés.
Le troisième regroupement est organisé autour de deux présentations.
Sylvie Cèbe (Acté, Inspé de Clermont Ferrand) proposera une intervention sur « Les principes d’une pédagogie démocratisante: la place de l’explicitation » à partir notamment de l’analyse d’un corpus aux membres de Reseida.
Ghislain Leroy (Cread, Université Rennes 2) présentera son ouvrage « L’école maternelle de la performance enfantine ».
Lors de cette conférence, Ghislain Leroy reviendra sur les principales conclusions de son ouvrage, « L’école maternelle de la performance enfantine » (Peter Lang, 2020) et sur la manière dont elles ont évolué depuis. Quels changement au niveau des instructions officielles de l’école maternelle depuis une cinquantaine d’années ? A partir de quels concepts penser ces évolutions ? Mais surtout ; quid des pratiques contemporaines ? Il s’agira de les caractériser pédagogiquement (choix pédagogiques dominants ; question de la prise en charge ou non des élèves les moins bien dotés scolairement par leur milieu d’origine). Mais aussi plus généralement de penser ces pratiques comme engageant des projets éducatifs et politiques pour l’enfant qu’il convient de ne pas prendre pour allant de soi. En somme, nous nous interrogeons sur ce que l’on cherche à faire de l’enfant dans l’école maternelle contemporaine, et ce que cela a de spécifique par rapport à l’école maternelle passée ; il y a là une manière de s’interroger aussi, plus globalement et dans une perspective critique, sur les définitions sociales actuelles de l’enfance.
Le premier regroupement de l’année 2019-2020 des 28 et 29 novembre 2019 sera l’occasion de présenter la recherche ACCI (Adapations Curriculaires Contextualisées et Inégalités) à laquelle se consacre un des axes de RESEIDA depuis plusieurs années, il permettra également de travailler sur la notion d’explicitation, qui sera évoquée tout au long de l’année 2020.
Le regroupement de novembre sera ainsi l’occasion de présenter les avancées de la recherche ACCI. Cette recherche a pour originalité de ne pas porter directement sur les observations des activités en classe, mais sur les traces qu’elles laissent dans les cahiers. Le corpus analysé est constitué de cahiers de SVT et de français de 40 classes de 6ème d’établissements socialement contrastés. L’originalité réside également dans le traitement quantitatif des données recueillies. Il a conduit à une réflexion méthodologique importante sur la façon de transformer les observables d’éléments différenciateurs développés dans les recherches précédentes en objets « codables » et traitables statistiquement, puis d’identifier le type de traitement statistique susceptible de mettre au jour les différences entre établissements, sujet de la recherche. Les résultats, significatifs, permettent de mettre au jour des configurations d’éléments qui constituent des différences d’exigences cognitives et langagières. Enfin, la recherche permet aussi de montrer l’évolution de la fonction des cahiers qui va sans doute de pair avec la place grandissante de l’oral dans les pratiques enseignantes, éléments susceptibles d’accroître les inégalités sociales.
Le second regroupement de l’année 2019-2020 qui aura lieu les 3 et 4 février 2020 rassemblera deux interventions:
Jean-Yves Rochex interviendra en premier lieu le matin sur l’explicitation
Christian Maroy interviendra l’après-midi sur la mise en œuvre de politiques d’accountability
Jean-Yves ROCHEX : « Enseigner plus explicitement : conceptions, débats et controverses »
Ces dernières années ont vu, en France comme dans d’autres pays, la montée en puissance – dans les débats sociaux, scientifiques et professionnels, mais aussi dans nombre de textes officiels récents – de la thématique de « l’enseignement explicite » ou du souci d’« enseigner (plus) explicitement », voire de mettre en œuvre une « pédagogie explicite ». On n’en donnera pour preuves que le fait que l’objectif d’« enseigner plus explicitement » apparaisse comme la priorité numéro 1 du Référentiel pour l’éducation prioritaire publié par la DGESCO en janvier 2014 et complété par un dossier éponyme publié par la DGESCO en décembre 2016, ou encore l’affirmation, en particulier au Québec et, plus récemment en Belgique, d’une véritable « école », voire de véritables lobbies visant à imposer une conception « anglo-saxonne » de l’enseignement explicite comme seule approche pédagogique efficace.
Cette thématique – à la fois question de recherche et préoccupation professionnelle – donne lieu, légitimement, à divers questionnements et controverses sur ce qu’elle désigne et sur la manière dont elle éclaire ou non les débats sur les politiques et les pratiques éducatives. Ce d’autant plus qu’elle croise d’autres questionnements et notions, relevant de divers champs (sociologie, didactiques, psychologie, « science de l’enseignement…), et portant, selon des formulations différentes toujours porteuses de sens et d’approches différents, sur « l’effet enseignant », « les effets » ou « l’efficacité » des pratiques enseignantes, les modalités de recherche et d’enquête permettant de les évaluer, ou encore les logiques et processus de dévolution, d’institutionnalisation, de différenciation, de régulation de l’activité des élèves, etc…
Ce champ de controverses, au sein duquel les anathèmes et revendications d’usages exclusifs du terme d’enseignement explicite ne manquent pas, semble s’organiser historiquement à partir de deux pôles et conceptions de cette question. D’un côté, un questionnement sociologique, ou socio-didactique, prenant sa source dans les travaux de Bourdieu et de Bernstein, dans leurs conceptions et propositions de pédagogie explicite vs implicite, visible vs invisible, questionnement dont les travaux de RESEIDA, des chercheurs et laboratoires qui constituent le réseau, se nourrissent et qu’ils ont contribué à documenter, à développer et à préciser. De l’autre un courant, issu de travaux anglo-saxons reposant sur une approche qui conjugue psychologie d’inspiration comportementaliste et visée économétrique de mesure de l’efficacité des pratiques d’enseignement, et qui mène ouvertement bataille contre les approches qu’il qualifie de (socio-)constructivistes et pour une pédagogie « teacher led », en polémiquant au besoin contre les travaux et recommandations issus du courant précédent.
On tentera, pour nourrir la réflexion de plus long terme qui se mène sur ces questions au sein de RESEIDA, de revenir sur ces amonts, sur les questionnements, les recherches empiriques et les élaborations conceptuelles qui les fondent, en essayant de prendre en compte des travaux et propositions plus récents empruntant à d’autres questionnements et approches théoriques (didactiques, psychologie et approches métacognitives, régulation des apprentissages…)
Christian Maroy : « L’autonomie professionnelle des enseignants à l’épreuve d’une nouvelle gestion de la pédagogie au Québec »
Depuis le début des années 2000, le Québec (Canada) a développé une politique d’accountability basée sur les performances – appelée Gestion axée sur les résultats (GAR) – qui touche l’ensemble du secteur de l’éducation obligatoire de cette province. Cette politique, inspirée des outils et des idées de la Nouvelle Gestion Publique, se déploie à tous les niveaux du système éducatif (ministère, commissions scolaires et établissements) (Dembélé & al., 2013 ; Maroy & al, 2015). Elle met en place des outils de planification, de contractualisation, des cibles de performance et des indicateurs de résultats dont plusieurs sont basés sur les acquis des élèves testés aux examens ministériels ou sur des statistiques de diplômation ou de décrochage. Cette politique d’accountability semble à « enjeux faibles » (peu ou pas d’incidence sur l’emploi ou les salaires des directions d’école ou des enseignants) (Maroy & Voisin, 2013 et 2014). Cependant, nous montrons qu’elle tend à produire plusieurs des dérives et des effets indésirés constatés dans les systèmes d’accountability à enjeux forts (réduction curriculaire, « teaching to the test », triche) (Rozenzwayn & Dumay, 2014).
La politique de « gestion axée sur les résultats » (GAR) a été mise en œuvre de façon pro-active par les Commissions scolaires (CS) en appliquant non seulement les prescriptions légales, mais en mettant en action un ensemble d’outils statistiques et managériaux mais aussi pédagogiques qui permettent un suivi et un accompagnement professionnel des équipes enseignantes et d’effectuer diverses pressions au changement (Maroy & al, 2017). Ces outils ont permis le développement d’une gestion effective des pratiques pédagogiques, gestion qui jusque là était seulement évoquée discursivement par le discours sur le leadership pédagogique. Les gestionnaires appuyés par divers professionnels (analystes, conseillers pédagogiques) visibilisent, évaluent et régulent certaines pratiques pédagogiques des enseignants, car elles sont associées aux cibles de résultat des écoles et aux redditions de compte que l’école ou la CS doit faire sur son efficacité.
Notre présentation insistera sur les conséquences de ce nouveau modèle de gestion scolaire sur l’autonomie professionnelle (Freidson, 2001) et les pratiques des enseignants. Nous montrerons que la GAR tend à réduire la latitude de choix des enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements et les pratiques d’évaluation, alors que les relations et méthodes pédagogiques sont moins touchées. On assiste donc à une tendance à la déprofessionnalisation des enseignants (Demailly et de la Broise, 2009).
Nous analyserons aussi la diversité des réponses faites par les enseignants à ces pressions institutionnelles (Coburn, 2004). Notre analyse montre que les réponses les plus fréquentes sont le rejet et l’accommodation, mais aussi le renoncement à certaines pratiques souhaitées, soit des pratiques « empêchées » par la mise en œuvre de la GAR, un type de réponse qui s’ajoute donc à la typologie de Coburn.
Basé sur un cadrage théorique pluriel (sociologie de l’action publique et des groupes professionnels, sociologie néo-institutionnaliste), cet exposé s’enracine dans une étude qualitative des logiques de mise en œuvre de la GAR dans 4 CS (61 interviews et analyse documentaire). Au niveau des établissements, elle se base sur des entretiens auprès d’enseignants (N = 21) et de membres des équipes de direction (n=8) de quatre établissements secondaires. Elle fait partie d’un programme de recherche large sur les politiques d’accountability.
Le regroupement est annulé en raison de la situation sanitaire
Le premier regroupement de l’année universitaire a lieu le 19 novembre 2018 (10h, bâtiment Halle aux farines, salle 471E) et 20 novembre (9h30, bâtiment Halle aux farines, salle 247E). Il est organisé autour de la présentation de l’ouvrage de Julien Netter (Escol, UPEC) « Culture et inégalités à l’école. Esquisse d’un curriculum invisible » et d’une discussion sur les travaux des différents axes du réseau.
Cette recherche rend compte d’une recherche réalisée dans le cadre d’une convention CIFRE entre le CIRCEFT-ESCOL et la Mairie de Paris (Direction des Affaires scolaires). Le chercheur présentera des exemples d’activités réalisées à l’école et en dehors de l’école dans le but d’amener la notion de curriculum invisible. Il cherchera ensuite à définir cette notion au regard d’autres formes de curriculum, les curricula formel, réel et caché et à montrer son utilité, complémentaire des autres formes.
Le deuxième regroupement a lieu les 11 et 12 mars 2019, avec des interventions d’Aurélie Chesnais, Benjamin Moignard et deux demi-journées consacrées au travail au sein des axes.
Les « nouvelles » problématiques éducatives. La transformation des systèmes éducatifs au prisme de ce qui fait problème à l’école, et de « ceux » qui lui font des problèmes.
Benjamin MOIGNARD, Université Paris-Est-Créteil, LIRTES-PARSIE, OUIEP.
Cette intervention propose de rendre compte de la notion de « nouvelles » problématiques éducatives (NPE), à partir de laquelle nous interrogeons les formes de désignations, de diffusion et de publicisation d’un certain nombre de problèmes scolaires et éducatifs dans l’espace public.
Ces NPE renvoient à des objets tel que l’échec scolaire, la violence à l’école ou le décrochage scolaire par exemple, et sont envisagées à la fois pour elles-mêmes et comme un moyen d’analyser l’état des systèmes éducatifs, que ce soit au regard des pratiques qu’elles génèrent, des publics qu’elles désignent, des configurations organisationnelles qu’elles engagent ou des politiques qu’elles suscitent. Nous cherchons donc, à partir de l’étude de la mise en problème d’un certain nombre d’objets, de la désignation de « ceux » qui les produisent, et des mobilisations institutionnelles qu’elle justifie, à interroger les transformations des systèmes éducatifs contemporains et ce qu’elles disent des reconfigurations des inégalités socio-scolaires en contexte.
Nous évoquerons les conditions d’émergence dans l’espace scolaire et éducatif de certains problèmes, et interrogerons les rapports entre logiques politiques et logiques d’actions dans la définition de cet objet scientifique. Les NPE sont l’occasion de saisir des nuances comme des transformations à grande échelle dans le rapport à ce qui fait problème à l’école, alors que nous ne sommes ni face à des nouveautés radicales, ni dans une forme de continuité, mais bien plutôt dans un rapport de reconfiguration de ces faits sociaux.
Aussi, nous chercherons à mettre en perspective une démarche sociologique qui considère les problèmes de l’école non pas comme des états, mais comme le résultat d’un processus historicisé de désignation, de valorisation et de publicisation de ce qui fait problème et de « ceux » qui lui font des problèmes, et comme la marque de processus de confrontations et d’interactions entre les acteurs en situation. Traiter de cette question nous permettra de revenir sur les modalités de construction de cet objet pour aborder des enjeux épistémologiques et théoriques plus généraux liés à la recherche en éducation.
Un point de vue de didactique des mathématiques sur les inégalités scolaires.
Aurélie Chesnais, LIRDEF (EA 3749), Université de Montpellier, aurelie.chesnais@umontpellier.fr
Cette présentation s’appuiera sur les première et troisième parties de ma note d’Habilitation à Diriger des recherches. Je propose ainsi tout d’abord de (re-)mettre en discussion la distinction faite entre différenciation passive et active dans les travaux du réseau RESEIDA à partir de la synthèse des travaux que j’ai menés concernant la variabilité des pratiques enseignantes en mathématiques au début du secondaire en fonction du contexte (éducation prioritaire ou non), et les effets de ce qui se déroule dans les classes sur les apprentissages des élèves, enfin la question des alternatives. Dans un deuxième temps, je proposerai des pistes de recherche concernant le lien entre la construction des inégalités scolaires et le rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques.
Le troisième regroupement a lieu les 20 et 21 mai 2019.
Le premier regroupement de novembre 2017 sera essentiellement consacré à la question des modalités et dispositifs d’aide aux élèves en difficulté, ce à partir de deux interventions. D’une part, Corinne Marlot (HEP Lausanne) et Marie Toullec-Théry (CREN, Université de Nantes) présenterons, sous le titre « Co-enseignement et différenciation pédagogique : réinternalisation de l’aide ordinaire au sein du collectif de la classe ? », les travaux qu’elles conduisent depuis quelques années sur le dispositif national Plus de maîtres que de classe et les modalités de sa mise en œuvre.
D’autre part, Caroline Viriot-Goeldel (UPEC, ESCOL-CIRCEFT) a présenté, à partir du travail réalisé pour son HDR, un bilan-synthèse des travaux portant sur le dispositif dit de « Réponse à l’intervention » visant à apporter une aide aux apprentis-lecteurs en difficulté, bilan à partir duquel elle a analysé la situation française, dans une intervention intitulée « Aider l’apprenti-lecteur en difficulté. Analyse du cas français à la lumière de la Réponse à l’intervention ». Les groupes de travail thématiques se sont également réunis lors de ce regroupement.
Le second regroupement de l’année des 2 et 3 février 2018 est l’occasion de discuter à partir d’une intervention d’Elsa Roland (ULB) sur les dispositifs éducatifs depuis le XIVème siècle.
Elsa Roland, de l’Université Libre de Bruxelles, présentera son travail de thèse intitulé « Généalogie des dispositifs éducatifs en Belgique du XIVème eu XXème siècle », qui adopte une perspective transdisciplinaire répondant à la spécificité des sciences de l’éducation. Elle cherche à mieux comprendre la normalisation des pratiques éducatives et la disciplinarisation de la jeunesse et de l’école en Belgique, la libéralisation des rapports de domination, l’émergence de méthodes concurrentes qui ont été pour certaines par la suite interdites.
Le regroupement des 30 et 31 mai 2018 est organisé autour de deux interventions:
Laurent Veillard sur la formation professionnelle en lycée professionnel
Philippe Vitale sur une histoire de la sociologie du curriculum telle qu’analysée dans son HDR.
Laurent Veillard : « Les modalités du cadrage des élèves à l’atelier automobile »
Cette recherche ethnographique, qui adopte une approche pluridisciplinaire (didactique, sociolinguistique) est inspirée d’un cadre théorique proche des orientations de Reseida, en particulier par ses références au travail du sociologue britannique B. Bernstein. Le chercheur s’intéresse à la manière dont des élèves en CAP maintenance automobile passent des enseignements généraux aux enseignements professionnels (mécanique, technologie) en atelier. L’autonomisation, qui est au cœur des enjeux des enseignants, semble être un échec. Des différences importantes existent entre ce qui est attendu dans la pratique professionnelle et ce qui est proposé de réaliser aux élèves. Cette présentation a contribué à l’élargissement de la réflexion du réseau à l’enseignement professionnel, segment du système éducatif qui avait jusqu’ici peu été objet de ses préoccupations.
Philippe Vitale: « Le curriculum et ses sociologies : une introduction »
À la suite de sa soutenance d’HDR consacrée à cette question, le chercheur revient sur la notion de « sociologie du curriculum » et présente les différences de conception de cette notion dans les travaux français et anglo-saxons et leur intérêt, tant pour l’étude des politiques éducatives et des dispositifs dans lesquels elles se concrétisent, que pour celle des pratiques professionnelles et de leurs modalités d’adaptation aux différents contextes, en particulier aux contextes de précarité et de vulnérabilité sociales.
Jeudi 5 janvier 2017
Salle 165 E du bâtiment Halle aux Farines.
À partir de 10 heures, intervention de Christophe Delay (Haute École de Travail social et de la Santé – Lausanne) : « Classes populaires et devenir scolaire enfantin : un rapport ambivalent ? »
Plusieurs travaux ont souligné l’essor en France des ambitions scolaires des familles populaires tout comme leur variabilité en fonction de l’origine nationale ou des scolarités juvéniles. Cette contribution revisite ce débat au moyen de deux enquêtes qualitatives réalisées en Suisse romande. Un accent particulier sera posé sur les propos ambivalents des familles quant à la poursuite d’études longues de leurs enfants à l’école primaire. Puis, l’analyse de quelques portraits sociologiques auprès d’élèves orientés dans des filières préprofessionnelles permettra de réfléchir à la manière dont les jeunes s’approprient ces messages au moment de la transition vers les formations post-obligatoires en fonction de leur trajectoire scolaire, de leurs notes, des configurations familiales mais aussi des conseils enseignants ou du groupe de pairs.
À partir de 14 heures, intervention d’Ariane Richard-Bossez (ESPEAix-Marseille), « Savoirs, pédagogie et apprentissages différentiels à l’école maternelle ».
Le propos portera sur mon travail de thèse relatif à la construction des savoirs à l’école maternelle, ses inégalités et ses moments de démocratisation. Après avoir présenté mon approche théorique et méthodologique, je développerai cinq dimensions que j’ai plus spécifiquement étudiées : l’institutionnalisation des savoirs dans les curricula de l’école maternelle, leur reconfiguration pragmatique dans les classes par les enseignants, leur interprétation différenciée par les élèves, les possibilités de révision des savoirs au cours des interactions en situation ; les jugements sociaux attribués aux apprenants dans les activités scolaires. L’analyse de ces cinq dimensions et de leurs interrelations fera ressortir différents processus d’ouverture ou de fermeture des possibilités d’apprentissage. Cela permettra ainsi de questionner la manière dont l’école maternelle intègre cognitivement mais aussi socialement les élèves qui lui sont confiés dans les apprentissages scolaires.
Vendredi 6 janvier 2017
9h30-10h30/11h : échanges sur l’avenir du réseau. Problèmes administratifs et orientations de travail. Salle 165 E.
À partir de 10h30/11h, travail par axes (aux responsables des trois axes d’organiser ce temps de travail). Nous disposerons pour cela des salles 165 E, 123 C et 125 C.
Jeudi 23 mars 2017
Amphi 2 A du bâtiment Halle aux Farines.
10h – intervention de Barbara Fouquet-Chauprade (Uni. De Genève) et de Marion Dutrévis (Service de Recherche en Éducation de Genève), « Les effets de la labellisation en contexte d’éducation prioritaire ».
Depuis quelques décennies et dans un grand nombre de pays se sont développées des politiques d’éducation prioritaire, qui sont conçues comme des outils de lutte contre les inégalités scolaires. Ces politiques prennent des formes très variées. Elles ont toutefois en commun de mettre en œuvre un effet de label. Nous faisons l’hypothèse que celui-ci génère un processus de catégorisation qui n’est pas sans conséquence pour les acteurs scolaires concernés (Dutrévis & Fouquet-Chauprade, 2016 ; Fouquet-Chauprade & Dutrévis, soumis). Durant cette présentation, nous développerons les arguments théoriques, tant sociologiques que psychologiques, qui étayent cette hypothèse de labellisation. Nous présenterons ensuite le contexte genevois, son réseau d’enseignement prioritaire et ses spécificités. Puis nous verrons comment mettre à l’épreuve des faits cette hypothèse de labellisation en questionnant à la fois les directeurs d’établissement, les enseignants, et les élèves de l’école primaire genevoise. Des premiers résultats permettront de nourrir la discussion. _ Références bibliographiques : Dutrévis, M., & Fouquet-Chauprade, B. (2016). Labelliser des territoires. Les risques de stigmatisation en éducation prioritaire. Diversité, 186, 59-64. Fouquet-Chauprade, B., & Dutrévis, M. (soumis). Le rôle des attentes enseignantes en contexte d’enseignement prioritaire. In B. Fouquet-Chauprade et A. Soussi (Eds.), Pratiques pédagogiques et enseignement prioritaire. Peter Lang
14h – intervention d’Ariane Richard-Bossez (ESPE Aix-Marseille) et Christophe Joigneaux (Escol-Circeft, Upec) : lectures croisées des ouvrages L’école des incapables ?, de Mathias Millet & Jean-Claude Croizet, La Dispute, 2016 et Sociologie de l’école maternelle, de Pascale Garnier, PUF, 2016.
L’objet de ce temps de travail est de présenter et de confronter les principales thèses développées dans deux ouvrages récents consacrés à l’école maternelle : L’école des incapables ? La maternelle, un apprentissage de la domination de Mathias Millet et Jean-Claude Croizet et Sociologie de l’école maternelle, de Pascale Garnier. Ces deux ouvrages ont pour point commun d’être très critiques vis-à-vis des effets de l’école maternelle à partir de deux points de vue relativement opposés. Ainsi, Millet et Croizet voient dans la maternelle une première école de la domination où les Professeurs des Ecoles n’enseigneraient pas ou pas assez, tandis que Garnier lui reproche au contraire de s’être trop scolarisée et de ne se focaliser que sur l’aspect scolaire des apprentissages au détriment de la prise en compte d’un développement plus global de l’enfant. Après avoir présenté ces deux approches, la discussion se propose de revenir, d’une part, sur ce qui peut expliquer des points de vue aussi contrastés en termes de cadres théoriques et de modes d’investigation notamment. Et, d’autre part, sur les enjeux que cela peut recouvrir au niveau des missions confiées à l’école maternelle et de leur traduction dans les curricula, mais aussi au niveau de la construction des inégalités scolaires à ce premier maillon du système éducatif.
Vendredi 24 mars 2017
À partir de 9h30, travail par axes (aux responsables des axes d’organiser ce temps de travail).
Jeudi 8 juin 2017
Salle 1021 du bâtiment Sophie Germain, rue Albert Einstein, 75013 Paris (attention, ce n’est pas la Halle aux farines, notre « bâtiment habituel »)
À partir de 10 heures, intervention de Sylvain Broccolichi (Recifes, Université d’Artois), Christophe Joigneaux et Maira Mamede (ESCOL, UPEC – Paris 8), « Genèse des positionnements des Professeurs d’école face aux inégalités scolaires. Entre idéaux, formation initiale et socialisation professionnelle ».
À 14 heures, intervention de Gwenaelle Audren (Aix-Marseille Université), géographe qui présentera son travail de thèse récemment soutenu.
« Ma thèse intitulée « Géographie de la fragmentation urbaine et territoires scolaires à Marseille » s’attache à décrire les formes de la fragmentation urbaine à Marseille ainsi que leurs conséquences socio-spatiales à travers les modalités de l’offre scolaire au niveau du collège et les pratiques de choix des lieux de scolarisation à l’entrée en sixième, à plusieurs échelles, en 2006 et 2009. La carte scolaire impose aux familles un collège de secteur mais face aux importantes recompositions socio-territoriales urbaines, des décalages s’opèrent entre les collèges, les attentes éducatives des parents et les conditions locales de scolarisation. L’étude porte d’une part, sur la quantification et la localisation du phénomène de l’évitement scolaire à Marseille et d’autre part, sur l’analyse fine de contextes territoriaux, dans lesquels se développent plusieurs types de stratégies scolaires. Des pratiques scolaires hétérogènes soulignent le creusement des inégalités socio-résidentielles. L’analyse des stratégies des différents acteurs institutionnels et individuels permet d’appréhender les mécanismes de production d’un espace scolaire systémique et hiérarchisé, et les contextes locaux révèlent territoires scolaires multiples et différenciés ».
Vendredi 9 juin 2017
Travail par axes (aux responsables des axes d’organiser ce temps de travail).
Ces journées auront lieu dans les locaux de l’Université Paris 7 Denis Diderot, dans le bâtiment Halle aux farines, accès par le 10-16 rue Françoise Dolto ou le 9-15 Esplanade Pierre Vidal Naquet, 75013 Paris (métro ou RER Bibliothèque François Mitterrand) _
Lundi 6 juin 2016 _ Salle 410 B du bâtiment Halle aux farines. _
_ La journée du 6 juin sera consacrée à la présentation de travaux portant sur les questions de littératie, d’oralité et d’apprentissages scolaires.
- À partir de 10h00, le groupe « Discours scolaire » d’ESCOL présentera ses travaux en cours sur le thème « Textes composites, pratiques de classe, littératie papier et littératie numérique ».
Lire la présentation de l’intervention
Textes composites, pratiques de classe, littératie papier et littératie numérique _ Groupe « Discolaire » _ _ Le groupe composé de C. Viriot Goedel, E. Vinel, P. Richard Principalli, T. Pagnier, . B. Lavieu-Gwozdz, G.Ferone, C. Delarue Breton, J. Crinon, E. Bautier travaille depuis plusieurs années sur l’introduction des documents composites (voir le texte Bautier et alii, Repères, 2012) comme supports de travail du point des vue des éventuels obstacles qu’ils peuvent constituer pour une partie des élèves dans la compréhension et l’acquisition des savoirs disciplinaires. Dans un premier moment de cette recherche, nous avons essentiellement analysé les difficultés, les manières de faire des élèves avec des doubles pages de manuels sans référence à la classe (lecture d’albums, puis d’une double page de manuel de sciences, d’histoire ou de géographie, puis production d’un écrit par l’élève, écriture de l’élève et entretien individuel avec les élèves pris individuellement). Dans un second temps, nous poursuivons le travail sur ces difficultés d’une part en observant les pratiques de classe des enseignants avec ces documents, d’autre part, en comparant les usages que font élèves et enseignants de documents papier et numériques. Il s’agit d’identifier non seulement la façon dont les enseignants prennent connaissance des difficultés des élèves et les prennent en charge, mais surtout ce que ces documents induisent comme pratiques de classe (comment ils utilisent en réalité ces documents, comment ils mettent les élèves au travail, quelle recomposition des documents effectuent-ils, quel statut pour les textes de savoir ?). _ L’exposé portera sur ces pratiques de classe qui permettent d’identifier comment les séances conduites en appui sur de tels documents accroissent les obstacles rencontrés par une partie des élèves : réduction de la complexité du document par un découpage du document et des séances, segmentation très grande des contenus, activités de manipulation incessantes des élèves… Nous cherchons à savoir si les difficultés et malentendus que ce type de support pouvait entretenir étaient levés par la « médiation » pédagogique et notamment comment (et si) la discontinuité et la triple hétérogénéité du support étaient prises en charge par l’enseignant. _
- À partir de 14 heures, Marceline Laparra et Claire Margolinas interviendront sur le thème « Les premières situations scolaires à la loupe. Des liens entre énumération, moralité et littératie », à partir de l’ouvrage éponyme qu’elles ont rédigé pour les éditions De Bœck (à paraître en septembre 2016).
Lire la présentation de l’intervention
Les premières situations scolaires à la loupe Des liens entre énumération, oralité et littératie _ Marceline Laparra & Claire Margolinas _ _ Dans le séminaire, nous donnerons un aperçu de certains éléments de notre livre à paraître chez de Boeck en septembre 2017 dans la collection dirigée par Sabine Kahn et Bernard Rey. Dans ce livre, nous nous intéressons en particulier au continuum oralité / littératie. _ La quatrième de couverture du livre (version non définitive) donne un aperçu de l’ouvrage. _ _ Didacticienne du français (Marceline Laparra) et didacticienne des mathématiques (Claire Margolinas), nous observons ensemble les difficultés des premiers apprentissages scolaires (élèves de 5 à 7 ans en dernière année d’école maternelle et première année d’école primaire) depuis une dizaine d’années. Ce livre propose d’examiner à la loupe les difficultés et les réussites des élèves dans des situations scolaires qui sont ordinaires en français et en mathématiques, suivant deux points de vue complémentaires : anthropologique et didactique. Il s’agit de révéler certaines connaissances utiles mais sous-estimées ou mal connues, en particulier l’énumération. Il est en effet difficile, pour l’adulte qui sait lire et compter, de comprendre les situations dans lesquelles les élèves se trouvent effectivement et de déterminer les connaissances qui sont en jeu. Il est nécessaire pour cela de prendre en compte en particulier deux univers : celui de l’oralité et celui de la littératie. L’étude de ces deux univers est au cœur de cet ouvrage, dont l’ambition est de permettre aux enseignants de mieux enseigner à tous les élèves et donc de ne pas aggraver les inégalités scolaires.
_ Mardi 7 juin 2016
- à 9h30, salle 122 C de la Halle aux Farines, Géry Marcoux, de la FAPSE de l’Université de Genève interviendra sur le thème « Croyances et connaissances des enseignants : quels effets sur le redoublement ? ».
Lire la présentation de l’intervention
Croyances et connaissances des enseignants : quels effets sur le redoublement ? _ Géry Marcoux (Université de Genève) _ _ Dans de nombreux systèmes éducatifs, le redoublement reste en usage avec une forte adhésion des enseignants alors que la littérature scientifique conclut à son inefficacité, voire à ses effets négatifs. Cet état de fait interpelle. _ Dès lors, nous aurons à cœur de montrer, dans un premier temps, que de notre point de vue, toute décision de redoublement est la résultante d’un processus évaluatif dans lequel les notes ne sont que partiellement déterminantes impliquant des jugements normatifs s’appuyant sur une « théorie personnelle » au sens où la croyance aux bienfaits du redoublement s’intègre dans un réseau d’idées, convictions et représentations de l’enseignant (Marcoux & Crahay, 2008). _ Dans un second temps, nous développerons l’idée que pour comprendre ces décisions, c’est tout le fonctionnement évaluatif des enseignants qu’il importe d’étudier. A cette fin, nous présenterons les principaux résultats du programme de recherche que notre équipe a mené au cours de la période 2010-2014 (Crahay & Marcoux, 2010) et tenterons deux modèles heuristiques : l’un essayant de comprendre comment se construisent les croyances et les connaissances des enseignants concernant le redoublement (Marcoux, Boraita & Crahay, 2016), l’autre, cherchant à déterminer comment se prennent les décisions de redoublement (Marcoux & Crahay, accepté).
_ Crahay, M. & Marcoux, G. (2010). Comment et pourquoi les enseignants décident du redoublement de certains élèves ? Projet approuvé et attribué pour la période 2010-2014 : FNS n°132218. Berne : Fonds national suisse de la recherche scientifique. _ Marcoux, G. & Crahay, M. (2008). Mais pourquoi continuent-ils à faire redoubler ? Essai de compréhension du jugement des enseignants concernant le redoublement. Revue suisse des sciences de l’éducation, 30(3), 501-518. _ Marcoux, G., Boraita, F. & Crahay, M. (2016). A propos de la structuration, de l’enracinement culturel et de la modifiabilité des croyances des enseignants sur le redoublement : synthèse d’un programme de recherche FNS. Revue suisse des sciences de l’éducation, 38(2). _ Marcoux, G. & Crahay, M. (accepté). Le redoublement des élèves : des décisions prises dans l’incertitude. In P. Detroz (Ed.). Ouvrage collectif issu du 27e colloque international de l’Adméé. _ _ Biographie Après avoir enseigné pendant dix ans dans l’enseignement secondaire inférieur à Bruxelles et suivi un master en Sciences de l’éducation à l’Université libre de Bruxelles, Géry Marcoux a rejoint l’équipe du Professeur Marcel Crahay à Genève en 2006. Une première recherche commune les amènera à écrire un article au titre évocateur : « Mais pourquoi continuent-ils à faire redoubler ? » Cet essai, dans lequel ils tentent de mieux comprendre les décisions des enseignants concernant le redoublement, les conduira à proposer et codiriger de 2010 à 2014 un Fonds National Suisse de recherche intitulé : « Comment et pourquoi les enseignants décident du redoublement de certains élèves ? » Aujourd’hui, la poursuite de leurs travaux ambitionne de mettre en évidence et de mieux comprendre les relations des croyances des enseignants et futurs enseignants relatives au redoublement avec leur connaissance des recherches sur les effets du redoublement ainsi que d’autres catégories de croyances : intelligence, apprentissage, évaluation, justice.
Les axes se réuniront le mardi après-midi (les responsables d’axes en organisent le travail) et disposeront pour cela des salles 122C, 123C et 124C.
Jeudi 11 février 2016 : deux séances de travail en plénière.
Lieu : Salle 165 E, dans les locaux de l’Université Paris 7 Denis Diderot, dans le bâtiment Halle aux farines, accès par le 10-16 rue Françoise Dolto ou le 9-15 Esplanade Pierre Vidal Naquet, 75013 Paris (métro ou RER Bibliothèque François Mitterrand). _
- 11 février – 10 heures, salle 165 E
_ Travaux de l’Axe 3 : D’un ouvrage à l’autre. Des frontières à la temporalité. _ Les collègues de l’Axe 3 de Reseida rendrons compte de leurs travaux et projets, depuis l’ouvrage qu’ils ont récemment publié (Aux frontières de l’école, sous la direction de P. Rayou, Presses universitaires de Vincennes – voir flyer ci-dessous) jusqu’à celui qu’ils ont en préparation.
Lire la présentation de ce travail
« Notre récent ouvrage (Aux frontières de l’école. Institutions, acteurs, objets, Presses universitaires de Vincennes) a été élaboré dans le cadre de l’axe 3 de Reseida. Il s’interroge sur la nature et l’état des frontières que l’école républicaine avait tracées entre elle-même et le reste de la société, supposées garantes d’une réussite due au seul mérite des élèves. Il avance l’idée que les frontières de l’école sont toujours bien réelles au sens où les savoirs qu’elle dispense et les façons dont elle les diffuse lui sont spécifiques même si ses manières les plus visibles d’instaurer une distance avec le monde extérieur sont en voie de disparition. Il propose des outils de compréhension d’une institution qui, loin de décliner, étend de mille et une façons son emprise sur la société et dont l’inégale maîtrise des codes par les différentes populations d’élèves crée entre eux de profondes et durables lignes de démarcation. _ Le projet d’ouvrage (Le temps des apprentissages) vise, après la dimension spatiale, à explorer la composante temporelle de la scolarisation. L’idée générale est d’analyser les tensions temporelles qui traversent l’école et que ne laisse pas apparaître une approche formelle, de l’organisation du temps. Cela peut se faire d’un triple point de vue qu’il nous semble possible de caractériser comme : anthropologique ; sociologique ; socio-didactique. Il s’agirait de partir de considérations générales sur la réalité du temps institutionnel confronté à celle des situations ; de montrer les enjeux sociaux des confrontations entre temps formel de l’école et temps réel de l’acquisition des dispositions temporelles scolaires ; de montrer que les processus d’apprentissage scolaire procèdent de temporalités complexes irréductibles à leur organisation curriculaire ». bloc> _ _ _
- 11 février – 14 heures, salle 165 E
_ Bertrand Daunay, Professeur à l’Université Lille 3 et membre du CIREL (EA 4354) qui nous proposera une intervention intitulée « L’imbécile : une interrogation du savoir scolaire », publiée dans un ouvrage collectif dirigé par lui- même et Jean-Louis Dufays.
Lire la présentation de l’intervention de Bertrand Daunay
« L’imbécile : une interrogation du savoir scolaire »
Je me propose de présenter une réflexion sur une figure que j’esquisse depuis de nombreuses années, par petites touches, et dont j’entreprends actuellement de manière plus systématique un portrait, celle de l’imbécile. Je l’emprunte à Henri Michaux, qui écrivait dans Ecuador, en 1929 :
« J’ai souvent remarqué, dans les études secondaires, que les élèves “imbéciles” butaient avec grande sûreté sur le hasardeux, le spéculatif et le nœud de la théorie proposée.
« Ils posaient des questions au professeur là-dessus, qui leur réexpliquait la chose. Eux cependant restaient songeurs, aux rires et ricanements de la populace des forts en thème.
« Dans la suite, j’ai remarqué que ces théories renversées par de successifs savants l’étaient justement par cet endroit où l’imbécile de quinze ans avait mis le doigt. »
Valoriser, à la suite de Michaux, cet imbécile-là, c’est se donner comme projet, dans une approche théorique didactique, de penser les difficultés des élèves par la connaissance des limites du savoir théorique – ce qui, en retour, permet de mieux penser le savoir théorique. J’illustrerai cette proposition par un retour sur des analyses que j’ai pu faire concernant la lecture ou l’écriture dans le secondaire (de la paraphrase à l’écriture d’invention) et sur la question plus générale de l’injonction à la distance, dont la naturalisation peut revenir à une valorisation des normes scolaires. J’ouvrirai ensuite mon propos en présentant une recherche plus récente (menée avec Daniel Bart) sur le PISA et un projet plus global de travail sur l’imbécile, dans une perspective didactique critique.
Vendredi 12 février 2016 : travaux de nos trois axes – groupes de travail
Axe 1 (recherche ACCI) : Halles aux Farines, salle 375 F _ Axe 3 : Halles aux Farines, salle 404 B. _ Les membres de ces axes seront informés des horaires de travail. _ _ L’axe 4 se réunira à Montreuil. Les membres de cet axe seront informés du lieu et des horaires choisis.
Programmation 2014-2015
Séance n°1
Les 3 et 4 novembre 2014 Université Paris 8
le lundi 3 novembre sera consacré aux travaux des trois axes.
Pour la recherche ACCI (adaptations contextualisées des curriculums), salle A045
Pour l’axe 3 (nouvelles frontières de l’école ?), salle D328
Pour l’axe 4 (doxas, croyances…), salle B132
Le mardi 4 novembre auront lieu, en séance plénière, deux interventions :
à 9h30, Benjamin Moignard et Stéphanie Rubi, « Encadrer les élèves perturbateurs ? Une sociologie de désordres scolaires »
à 14 h, Héloïse Durler (HEP Lausanne), « L’ “élève autonome“ : dispositifs pédagogiques et enjeux sociaux d’une injonction paradoxale. »
Séance n°2
Les 30 et 31 mars 2015
Programme
Lundi 30 mars : journée d’études sur les « Savoirs, conceptions et normes professionnelles des enseignants », proposée et organisée par les membres de l’axe 4 du réseau.
Lieu : Les archives nationales (salle des commissions 3-4), 59 rue Guynemer.
9h15 – 9h45 – Accueil et présentation (Sabine Kahn)
09h45 – 10h30 – Pensée, croyances et pratiques des enseignants (Géry Marcoux, Université de Genève)
10h30 – 11h00 – Discussion
11h00 – 11h30 – Méthodologie d’une enquête collective conduite par l’axe 4 de Reseida sur les conceptions et les normes des enseignants (Bruno Fondeville, Dominique Gelin et Georges Ferone)
11h30 – 12h00 – Analyse quantitative des données de l’enquête : méthode et résultats (Jacques Crinon, Georges Ferone et Eliane Fersing)
12h00 – 12h15 – Discussion
12h15 – 13h45 – Pause repas
13h45 – 14h15 – Analyse qualitative des données de l’enquête : méthode et résultats (Corinne Marlot, Marie Toullec-Théry et Nathalie Sayac)
14h15 – 14h40 – Discussion
14h40 – 14h55 – Pause
14h55 – 16h30 – En deux temps : analyse de discours du corpus de l’enquête : des conceptions aux doxas. Aspects théoriques, méthode et résultats (Elisabeth Bautier, Catherine Delarue-Breton, Catherine Dupuy, Jacques Crinon et Charlotte Bouko).
16h30 – 17h – Discussion
Argumentaire
Depuis quelques années, on assiste au développement de travaux de recherche qui, à partir d’approches méthodologiques qualitatives des pratiques d’enseignement et des conduites des élèves, cherchent à comprendre les processus de différenciation qui participent à la production des inégalités scolaires. Qu’ils s’inscrivent dans la tradition de la sociologie de l’éducation ou dans des disciplines plus récentes, comme les didactiques disciplinaires ou les approches comparatistes en didactique, ces travaux soulignent chacun à leur manière le rôle des pratiques scolaires dans la production des difficultés d’apprentissage qui touchent plus particulièrement – mais non exclusivement – les enfants issus de milieux populaires (Rochex & Crinon, 2011 ; Bautier & Rayou, 2009 ; Bonnéry, 2011 ; Pelgrims & Cèbe, 2010). Ces travaux mettent notamment au jour l’existence de logiques d’adaptation des enseignants et de l’enseignement aux élèves les plus faibles (Butlen & al., 2002 ; Félix et Saujat, 2008), en réponse aux dilemmes professionnels auxquels ils sont confrontés (Toullec-Théry & Marlot, 2013 ; Wanlin & Crahay, 2012). Ils attirent aussi l’attention sur le fait que ces pratiques d’enseignement se soutiennent d’un discours progressiste tant dans ses visées que dans les conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage qu’il revendique. C’est ainsi au nom de la réussite de tous les élèves, de la prise en compte des plus faibles d’entre eux, que les enseignants de l’école primaire revendiquent par exemple leur adhésion à une idéologie moderniste et constructiviste : rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages, donner du sens aux savoirs appris, faire manipuler les élèves, les motiver en proposant des situations ludiques et des supports authentiques constituent ainsi autant de leitmotivs (Vause, 2010 ; Zakaria, 2012). Paradoxalement, la mise en avant de ces principes confère un caractère conventionnel et normatif aux discours et aux pratiques ainsi produits. Par conventionnel et normatif, nous entendons désigner le fait que ces principes se présentent comme des normes professionnelles incontestables, qui relèvent d’une évidence partagée alors même que leur efficacité est soumise à d’autres conditions et en particulier à la mobilisation cognitive des élèves dans l’activité (et pas seulement dans les aspects superficiels des tâches). Si certaines formules prescriptives et certains principes pédagogiques se développent dans la sphère professionnelle, c’est sans doute parce qu’ils y exercent des fonctions structurantes. Rendre compte de la genèse de ces « prêts-à-penser » et de leurs fonctions (fonctions identitaires, de légitimation ou encore de préservation des « places et des faces » de l’ensemble des acteurs, par exemple) apparaît comme un enjeu important pour comprendre la manière dont ces normes professionnelles contemporaines organisent les significations sociales des pratiques scolaires. Au cours de ces derniers mois, une enquête a été conduite par l’axe 4 du réseau RESEIDA pour tenter de mieux comprendre les conceptions de l’apprentissage et de l’enseignement qui sous-tendent les pratiques des enseignants. Cette journée sera l’occasion de présenter les premiers résultats de cette enquête.
Références bibliographiques
Bautier, É. & Rayou, P. (2009). Les inégalités d’apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires. Paris : PUF. Bonnéry, S. (2011). Les définitions sociales de l’apprenant. Recherches en didactiques. Les cahiers Théodile, 12, 85-101. Butlen, D., Peltier, M.-L. & Pézard, M. (2002). Nommés en REP, comment font-ils ? Pratiques de professeurs des écoles enseignant les mathématiques en REP : cohérence et contradictions. Revue Française de Pédagogie, 140, 41-52. Pelgrims, G. & Cèbe, S. (2010). Aspects motivationnels et cognitifs des difficultés d’apprentissage : le rôle des pratiques d’enseignement. In M. Crahay et M. Dutrévis (dir.), Psychologie des apprentissages scolaires (pp. 111-135). Bruxelles : De Boeck. Rochex, J.-Y. & Crinon, J. (dir.) (2011). La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs d’enseignement. Rennes : PUR. Toullec-Théry, M. & Marlot, C. (2013). Les déterminations du phénomène de différenciation didactique passive dans les pratiques d’aide ordinaire à l’école élémentaire. Revue Française de Pédagogie, 182, 41-54. Vause, A. (2010). Les croyances et connaissances des enseignants de l’école primaire à propos de l’acte d’enseigner. Éducation & Formation, e-294. En ligne : http ://ute3.umh.ac.be/revues/ Wanlin, P. & Crahay, M. (2012). La pensée des enseignants pendant l’interaction en classe. Une revue de la littérature anglophone. Éducation et didactique, 6(1), 9-46. Zakaria, H. (2012). Que font les maîtres ? Pour un bilan de la rénovation pédagogique à l’école. Paris : La Dispute.
***
Mardi 31 mars : cette journée sera réservée, à partir de 9h30, au travail des axes, qui travailleront soit toute la journée, soit uniquement le matin, selon leur décision propre. Cette deuxième journée aura lieu dans les locaux de Paris 8.
Regroupements 2013-2014
Séance n°1
4 et 5 novembre 2013
Lieu : Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Lundi 4 novembre, 10h-17h, (B 132)
Matin : intervention de Jean-Marie Privat, Professeur à l’Université de Lorraine, Le silence des lignes.
L’après-midi sera consacré à un retour sur l’intervention de JM Privat, et sur les usages que nous faisons des notions de littératie, de raison graphique, dans nos propres travaux et réflexions. Elle sera introduite par deux interventions de Marceline Laparra et de Claire Margolinas.
Mardi 5 novembre, 9h30-17h
Réunions propres aux trois axes ou groupes de travail engagés dans des projets collectifs :
Salle D143 pour le groupe Adaptations curriculaires
Salle A2278 pour le groupe Nouvelles frontières
Salle A045 (la salle de réunion Escol) pour le groupe/axe 4
Séance n°2
30 et 31 janvier 2014
Lieu : Université Paris 8 Saint-Denis
Jeudi 30 janvier
salle D 143 (1er étage du bâtiment D), de 10 h à 17 heures ou 17 heures 30.
La matinée (10h à 12h) sera consacrée à la présentation (par E. Bautier) de l’état d’avancement de la recherche collective Adaptations curriculaires contextalisées et inégalités (ACCI), des hypothèses et problématiques sur lesquelles elle repose, de la manière dont elle s’inscrit en continuité et en dépassement des travaux précédemment menés au sein de Reseida, puis des modes de recueil et de traitement de données mis en œuvre, et des questions méthodologiques et théoriques que pose ce travail et sa mise en œuvre dans trois disciplines différentes en classe de 6ème.
L’après-midi sera consacré à la présentation (par Roland Goigoux) de la recherche collective qu’il pilote au sein de l’IFÉ, « Étude de l’influence des pratiques de l’enseignement de la lecture et de l’écriture sur la qualité des apprentissages au cours préparatoires », qui regroupe des membres de treize équipes universitaires (dont plusieurs équipes et collègues membres de Reseida).
Vendredi 31 janvier
La matinée sera consacrée, sur leur demande, à des réunions propres aux trois axes ou groupes de travail engagés dans des projets collectifs. La matinée commencera à 9h30. Les trois groupes auront bien évidemment la maîtrise de leurs horaires de travail.
Salle D328 pour le groupe Adaptations curriculaires
Salle A2278 pour le groupe Nouvelles frontières/axe 3
Salle A045 (la salle de réunion Escol) pour le groupe/axe 4
Regroupements 2012-2013
Séance n°1
Lundi 12 et mardi 13 novembre 2012 Université Paris 7
Lundi 12, 10 h – 12 h30 : Présentation des travaux de l’axe 3 « Pluralité, porosité des milieux et des pratiques dans/hors l’école, dans/hors la classe » et de son projet d’ouvrage collectif « Les nouvelles frontières de l’école ».
Lundi 12, après-midi : Travail en parallèle des axes 2 « Évolutions et adaptations curriculaires et pédagogiques », 3 et 4 « Formation et circulation des savoirs et des doxas pédagogiques entre recherche, formation et exercice professionnel ». Concernant l’axe 2, cette après-midi sera pour l’essentiel consacré au projet de recherche « Adaptations curriculaires contextualisées et inégalités » déposé par Escol en réponse à l’appel d’offres de la DEP et auquel d’autres membres de Reseida sont associés.
Mardi 13, 9 h 30 – 12 h : Intervention de Sylvie Cèbe (laboratoire ACTÉ, Université et IUFM de Clermont-Ferrand) : la mise en œuvre de Lectorino et Lectorinette par des enseignants de CE.
Mardi 13, 14h – 16 h : Retour et réflexions méthodologiques et théoriques sur la question des adaptations curriculaires et de leur saisie ; information sur les projets en cours.
Séance n°2
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2013 Université Paris 7
Jeudi 17 : Travail autour du thème « Sociologie(s) et didactiques(s) : questions posées et services rendus des unes aux autres », en lien avec la tenue en septembre dernier, à la HEP de Lausanne, d’un colloque international intitulé « Sociologie et didactiques : vers une transgression des frontières ? ». Philippe Losego, sociologue et responsable du comité scientifique de ce colloque introduira ce thème, entre autres à partir du bilan et des perspectives de travail qu’il tire de ce colloque, quant aux relations possibles ou souhaitables entre sociologie et didactiques. Deux interventions sont prévues par la suite sur le même thème, et à partir de la lecture des communications au colloque, par Élisabeth Bautier et J.-Y. Rochex .
Vendredi 18 matin : Travail en trois ateliers correspondants aux axes du réseau.
- Axes 1et 2 : à partir du projet de recherche Adaptations curriculaires contextualisées et inégalités.
- Axe 3 : Porosité, circulation des objets, des pratiques et dispositions
- Axe 4 : Circulation des savoirs et doxas, entre recherche, formation et exercice professionnel enseignant.
Vendredi après-midi : compte-rendu et échanges. discussion générale sur les projets et perspectives du réseau.
Séance n°3
Lundi 3 et mardi 4 juin 2013 Université Paris 7
Lundi 3 juin, 10 h – 12 h, intervention de Christophe Joigneaux « La littératie émergente : premiers usages de l’écrit et normes de réussite scolaire.
Lundi 3 juin, 12 h – 13 h, travail sur le projet de manuscrit « Les nouvelles frontières de l’école », élaboré par les collègues de l’axe 3 de Reseida.
Lundi 3 juin, après-midi, réunion par axes sur les projets en cours : le livre collectif pour l’axe 3, la recherche Adaptations curriculaires contextualisées pour les axes 1 et 2, l’enquête par questionnaire et le symposium REF pour l’axe 4.
Mardi 4 juin, 9h30 – 12 h, intervention de Jean-Claude Régnier (Université Lyon 2) et Marc Bailleul (Université de Caen) : « Autour de questions méthodologiques soulevées par la construction, le traitement et l’analyse des données utiles à la recherche en SHS. Quelques apports de l’analyse statistique implicative : de l’exploratoire au confirmatoire ».
Mardi 4 juin, début d’après-midi : compte-rendu des travaux et avancées des axes, et préparation de l’année 2013-2014.
UNIVERSITÉ PARIS 8 - SAINT DENIS PARIS EST - CRÉTEIL
ADRESSE
Université Paris 8 – Saint Denis
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex 02
INSPÉ de l’académie de Créteil
Rue Jean Macé
94380 Bonneuil sur Marne
DERNIERS ARTICLES
 Séminaire EPsyFor26 mars 2025 - 17 h 32 min
Séminaire EPsyFor26 mars 2025 - 17 h 32 min Journée d’études EPsyFor « Santé mentale : enjeux contemporains et approches pluridisciplinaires »26 mars 2025 - 17 h 25 min
Journée d’études EPsyFor « Santé mentale : enjeux contemporains et approches pluridisciplinaires »26 mars 2025 - 17 h 25 min